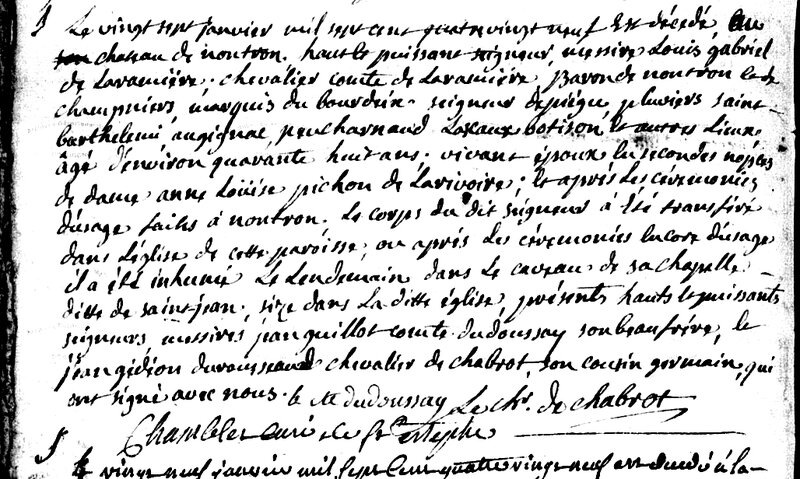Nous publions ici la déclaration de succession de la veuve de Jean Agard-Durantière, maître de forge, commune de Feuillade, département de la Charente. Le défunt est décédé sans laisser de testament, à 36 ans. En 1823, Louis XVIII, frère cadet de Louis XVI, est roi de France.
Déclaration retranscrite et éditée
Du premier juillet 1823.
Est comparu Dame Marguerite-Clarisse Jacques-Lanauve, veuve de Monsieur Jean Agard-Durantière, demeurante au village de Lamothe commune de Feuillade, agissant en qualité de tutrice de Marie & Guillaume Agard, ses enfants mineurs.
Laquelle a déclaré que les dits mineurs sont héritiers ab intestat dudit feu Agard-Durantière, leur père, décédé audit lieu de Lamothe le trente janvier dernier & qu’il leur est échu par le dit décès les biens dont la désignation suit, savoir :
Mobilier
Suivant inventaire dressé par Maître Lajartre, notaire à Marthon, les vingt-deux, vingt-quatre & vingt-cinq février dernier, enregistré le trois mars, le mobilier de la communauté conjugale établie par le contrat de mariage passé devant Debect, notaire à Villars canton de Lavalette le sept novembre 1813 enregistré le dix-huit, s’élève à la somme de …. 87,297.63 F
Plus, suivant acte reçu même notaire le trente juin dernier portant addition audit inventaire, à la somme de …. 3295 F
Total …. 90,592.63 F
Sur quoi il y a lieu de prélever :
1° au profit de la comparante la somme de dix-neuf mille francs pour partie de la dot non entrée en communautée, ci …. 19,000 F
2° Au profit du défunt celle de trente-neuf mille francs pour ses apports & dot non entrés en communauté …. 39,000 F
Total …. 58,000 F
Reste net partageable …. 32,592.63 F
Dont moitié pour la succession est de …. 16,296.32 F
À ajouter le prélèvement ci-dessus …. 39,000 F
Total …. 55,296.32 F
Reçu cent-trente-huit francs vingt-cinq centimes, ci …. 138.25 F
Immeubles
Acquêts
1° Un petit corps de domaine situé à Lacroix commune de Feuillade consistant en bâtiments, jardin, terres, vignes & bois châtaigniers, acquis de Pierre Rougier dit Léraillé & de Jeanne Nadal, sa femme, dudit lieu de Lacroix par acte du douze décembre 1817 devant Bourrinet, ledit domaine non affermé, évalué à un revenu annuel de cent-quarante-neuf francs quatre-vingt-dix centimes au capital de …. 2838 F
2° Quatorze ares de terre à Lamothe acquis de Philippe Bertrand par acte du huit mars 1818 devant Bourrinet, évalués à trois francs soixante centimes de revenu au capital de …. 24,000 F
3° La fonderie de Lamothe avec les ustensiles, les bâtiments & la maison neuve en dépendant, terre, lavoirs, jardin & terre se joignant, droit d’eau & d’écluse & un hectare un tiers de pré; le tout acquis de M. Guyot par acte du 16 juin 1818 devant Debect notaire à Villars, et évalué avec les forges à raison des constructions & augmentations faites depuis l’acquisition sus datée à douze-cent francs de revenu au capital de …. 24,000 F
4° Huit articles d’immeubles situés à Feuillade acquis de Léonard Janot par acte du 14 janvier 1823 devant Bourrinet, évalués à vingt-cinq francs de revenu au capital de …. 500 F
5° Trois lots d’immeubles situés à Lamothe commune de Feuillade consistant en bâtiments, jardins, maisons, terres, vignes, bois, prés & chaume; le tout acquis de Dame Julie Fargeas Lamothe, épouse Marchadier par adjudication du dix-huit juillet 1818 devant Lajartre, non affermé, évalué à trois-cent-quatre-vingt-quinze francs vingt-cinq centimes de revenu au capital de …. 7,905 F
Total …. 35,315 F
Dont moitié pour la succession est de …. 17,657.50 F
Propres
Elles consistent en immeubles jusqu’à concurrence de vingt mille francs constitués en dot au défunt par Monsieur Pierre Agard, maître de forge, à prendre dans les domaines qui lui appartiennent au lieu des Châtres commune de Savignac.
Reçu cent-soixante-seize francs soixante centimes, ci …. 176.60 F
Affirmant la présente déclaration sincère & véritable.
Veuve Durantière.
(AD 16, sous-série 3Q, déclarations de successions, bureau de Montbron)
Famille en arrière-plan
Jean Agard est né en 1786, au sein d’une dynastie de maîtres de forges, originaire de la commune de Savignac-de-Nontron, département de la Dordogne, fils de Pierre Agard et Pétronille Martinot.
Pierre Agard est propriétaire de plusieurs usines et en exploite d’autres, avec sa famille. Il est notamment le fondateur de la forge de Lavenaud, ou Laveneau, dans la vallée du Bandiat. Cet établissement occupe 120 personnes en 1811, dans une commune peuplée de moins de 400 habitants. Doté d’un haut fourneau, sa spécialité est la fabrication d’ustensiles de cuisine : poêles, casserolles, marmites, grils… etc.
Le grand-père, fils de forgeron, exploite la forge de chez Baillot avant son décès survenu en 1776.
Agard-Durantière se marie en 1813 dans l’église Saint-Cybard d’Ayras, aujourd’hui commune de Blanzaguet, département de la Charente.
Son fils unique et héritier, Ernest, est né en Dordogne, deux ans plus tard. Celui-ci a supervisé pour sa mère la construction du château de Montchoix avant de devenir plus tard maire de la commune de Rougnac.
Au moment de sa disparition, Agard-Durantière est directeur-propriétaire de la fonderie de Lamothe en Charente, ancienne forge à canons.
Généalogie simplifiée des Agard
I. Pierre Agard, maître-forgeron, marié avec Marie Faure, d’où Pierre Agard, qui suit.
II. Pierre Agard, maître de forge chez Baillot, marié avec Suzanne Dubreuil, d’où : 1° Pierre Agard-Brousson, qui suit ; 2° Autre Pierre Agard, négociant, marié avec Jeanne Millet.
III. Pierre Agard-Brousson, maître de forge chez Lavenaud, maire de Savignac-de-Nontron, marié avec Pétronille Martinot, d’où : 1° Jean Agard-Durantière, qui suit ; 2° Jean Agard-Aumont, garde d’honneur de la Dordogne, marié avec Françoise Aucouturier ; 3° Jeanne Agard, mariée avec Louis Agard-Mazière, maître de forge ; 4° Zoé Agard, mariée avec Charles Filhoud-Lavergne, médecin.
IV. Jean Agard-Durantière, maître de forge à Lamothe, marié avec Clarisse Jacques-Lanauve, d’où Ernest Agard-Durantière, propriétaire, maire de Rougnac, marié avec Marie Bourrut-Lacouture.
Source : Généalogie Charente Périgord.