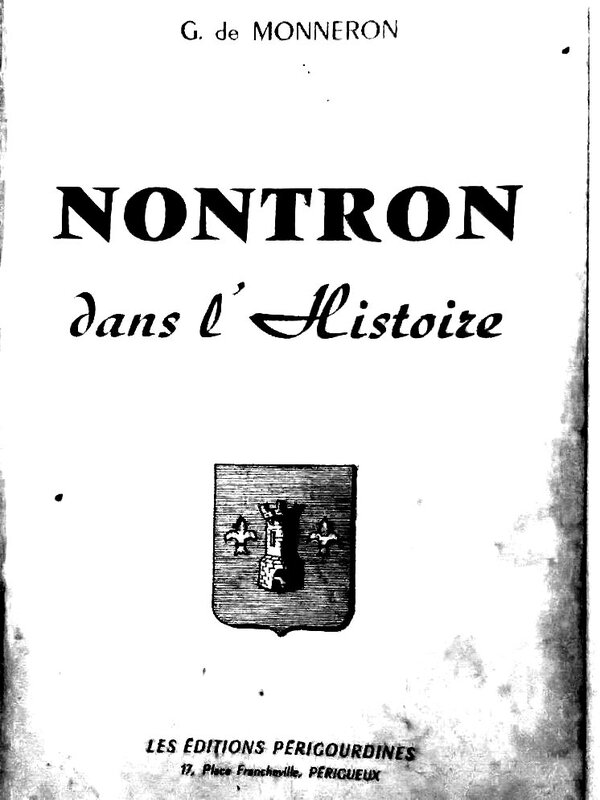Nontron, dans l’épopée napoléonienne a eu ses victoires et ses héros. Nombreux sont ceux qui tombèrent au champ d’honneur ; nous voudrions les connaître tous. Le 28 août 1813, Pierre Augustin de Mazerat fut tué lors de la déroute du 11e corps d’armée du maréchal Macdonald au combat de Lutzen en Silésie. Elève de l’Ecole polytechnique, il entra à l’école d’application de l’artillerie à Metz ; sorti lieutenant, il fut attaché au 1er régiment d’artillerie en garnison à la Fère, passa adjudant-major, puis capitaine commandant de la 2e compagnie du 5e régiment faisant partie de la Grande armée ; il débutat au combat de Wagram et fut décoré de la Légion d’honneur sur le champ de bataille. Depuis cette époque il fit toutes les campagnes de Napoléon, le suivit en Russie, reçut la croix d’officier de la Légion d’honneur. Il fit ensuite la campagne d’Autriche jusqu’à l’armistice de 20 jours au bout desquels commença une succession de batailles dont les résultats furent si funestes à la France. Trois jours avant la reprise des hostilités, le vaillant officier écrivit à sa mère pour lui annoncer la nouvelle faveur dont il était l’objet : titre de baron avec majorat de 4.000 francs. Peu de jours après la lecture de cette lettre, une réception étant donnée en son château, Madame de Mazerat se leva brusquement de son fauteuil, porta la main à son cœur et s’écria : « Oh ! ce coup de canon ! J’ai entendu le coup de canon qui vient de tuer mon fils ! » Elle retomba à demi-pâmée ; tous s’empressaient autour d’elle. Et comme le mois qui s’écoula sans nouvelle parut long ! Enfin parvint une enveloppe d’une écriture étrangère. Les dates furent confrontées ; par une sorte de dédoublement, particulièrement douée et sensible, la pauvre mère avait bien entendu la salve meurtrière. Par les états de service de ses enfants, Nontron a donc sa place dans l’épopée. Le lieutenant Excousseau fut également décoré et fait baron par l’Empereur sur le champ de bataille.
Généalogie Charente-Périgord (GCP)
Sélection d'articles sur le thème de l'Histoire et du Patrimoine.

-
Le 3 novembre 1625, sur le consentement de Mgr Raimond de la Marthonie, évêque de Limoges et à la demande des habitants s’établissent à Nontron les religieuses de Sainte Claire, dépendant de l’ordre et de la juridiction des Frères Mineurs de St François. Elles utiliseront pour leur couvent d’anciennes constructions hâtivement réparées — emplacement Ecole supérieure, au nord de la ville et le faubourg des Oliers deviendra la rue des Religieuses ; elles entreprennent d’élever une chapelle accompagnée d’une sacristie, d’un parloir, et comptent s’agrandir sur le pré qui leur a été cédé par contrat devant Lenoble et Lapouge, notaires. Elles sont au nombre de dix-huit religieuses de chœur, deux sœurs layes et deux novices. Elles ont apporté « une doct » ; la sœur de Ratinos (Ratineau), la sœur Jane de Rios (Eyriaud), la sœur Françoise de Labrousse… Nous voyons dans les prises d’habit ou entrées au noviciat les sœurs du Boucheron, de Monsalard, de la Grange, de Bort, Vidal de Lavergne, de Védrenne, de Bermondet, Dayquem de Saint-Alexis, de Pastoureau, Vieillemard, Larret de Grand-Pré, de Fargeot, de Lubersac… Anticipons. Voici les premières lignes d’un acte notarié : « Au parloir des Dames religieuses de l’ordre de Sainte Claire de la ville de Nontron, cejourduy, quinzième Octobre 1656, avant midy, ont este présents messire François de Conan, escuyer, seigneur de Connezat, la Bouchardière et autres places, et dame Marie du Chastain, son espouse, habitant son château de Connezat, paroisse du dict lieu, es Perigort, et Marguerite de Conan, demoiselle, leur fille naturelle et légitime, laquelle Marguerite, en présence des dicts seigneur et dame de Connezat, ses père et mère, parlant à dame Lageard, abbesse ; Jeanne de Monsalars, mère vicaire ; Marguerite de Labrousse, mère antienne ; Anne de Labreuilhe, Françoise Pastoureau, Anne de la Chatardyt, et Gabrielle de Bermondet, sœurs et mères discrètes, assistées de Jehan Rastineau, sieur de Moissac, leur syndiq apostolique, leur a dit et remontre qu’elle a lintention de se rendre religieuse au dict monastère soubs le bon plaisir de ses dicts père et mère, requerant que les dictes dames la y vouloir recepvoir… etc. » Marguerite de Conan deviendra « Sœur du Sauveur ». Les religieuses tenaient un pensionnat de jeunes filles appartenant à la noblesse et à la haute bourgeoisie. Le prix de la pension était de cent livres. On recevait aussi des dames de haut lignage ; la présidente d’Aguesseau s’était retirée à Sainte-Claire, versant une pension de 145 livres. Deux métairies furent achetées : La Cote et La Bucherie.
(Nontron dans l’Histoire)
-
L’auteur de cet ouvrage, édité en 1963, est la comtesse Gabrielle de Monneron (1882-1977), née Teyssandier de La Serve.
-
A Nontron est élu maire en décembre par suffrage restreint, M. Pastoureau de Labesse, en remplacement de M. de Labrousse de Lagrange, démissionnaire. Mauvaise année agricole ; l’hiver s’annonce glacial. Les Nontronnais plaident pour extérioriser leur hargne, ou comme dérivatif. Ces mesquines querelles détourent l’attention bien à propos des catastrophes menaçantes. La lutte est générale : les Nontronnais plaident ! Un cas entre vingt. Mme veuve Forien des Places, Marthe Arbonneau, rappelle aux juges du tribunal du district, qu’elle possède « dans la grande rue, une maison acquise au sieur Vieillemard, homme de loi, par contrat devant Me Grolhier ». Cette maison était séparée de celle de Me de Laborderie par un andronne ou ruette. M. Pastoureau de LAbesse, ayant acheté ce dernier lot il y a une dizaine d’années, a fait démolir la maison ainsi qu’un toit à cochons se trouvant dans l’andronne et il se dispose à élever un nouvel appentis en le surmontant d’une petite pièce, le tout « contre le mur de la maison, des éviers et latrines de l’exposante et avec un transport d’une immensité de pierres » ; elle accuse son voisin de vouloir diminuer la valeur de sa maison en la privant de jour, car elle comptait justement élargir l’étroite fenêtre d’une chambre fort obscure ; elle lui reproche de s’agrandir aux dépens d’une pauvre veuve chargée d’enfants et presque sans fortune, alors qu’il possède, de l’avis de tous, la maison la plus vaste et la plus commode de la ville. Elle revendique à tort la propriété de la ruette, s’en prend à son vendeur qui lui a garanti une paisible jouissance et cherche à faire intervenir le maître maçon Desport qui exécute ses travaux et ceux de la partie adverse. Elle fait monter des piles imposantes pour soutenir les tuyaux de descente de ses éviers et latrines, et fait boucher trois trous préparés pour une pose de solives, profitant pour cela d’une absence du sieur Pastoureau qui le lui reproche violemment. Elle réplique « qu’elle ignorait très certainement qu’il eut été à Toulouse conduire son fils dans une pension gratuite… » Et parce qu’il paraîtrait que le Sr Pastoureau aurait dit qu’il voulait plaider et avait 10.000 Fr. à mettre dans cette affaire, l’auteur de la requeste, Me Ribadeau du Mas, neveu de l’exposante, se laisse entraîner par le lyrisme de cette curieuse époque. « Le temps heureusement où les procès s’éternisaient à la faveur de la fortune d’un adversaire puissant, n’existe plus ; nous sommes tous devenus égaux aux yeux de la loi. Elle est aussi favorable à celui qui occupe une chaumière qu’à celui qui vit somptueusement sous des lambris dorés. » Les pièces s’entassent : tout un dossier pour une si mince affaire ! Elle a débuté ainsi : « Cejourd’hui, second du mois de décembre mil sept-cent quatre-vingt onze, environ les 10 heures du matin en la ville de Nontron et dans la maison du sieur Excousseau aîné où nous tenons ordinairement notre bureau de paix et d’audiences, par devant nous, Léonard Grolhier des Virades, est comparue Dlle Marthe Arbonneau, veuve de feu sieur Forie tant en sa propre qualité qu’en celle de tutrice et curatrice de ses enfants… » Celle-ci réédite donc son éxposé ; celui du Sr Pastoureau est encore plus long. Le sieur Pierre Vieillemard et le maître maçon Desport sont convoqués. « Attendu qu’il s’agit d’une propriété et d’un droit de servitude qui sont des droits rééls », le juge de paix se déclare finalement incompétent et renvoie les parties devant le tribunal de conciliation. Plusieurs notables ont été consultés, mais la situation est délicate ; la solution sera fera longtemps espérer. Les adversaires ont les même relations, la même parenté plus ou moins proche, et les élections ont eu lieu ! M. Pastoureau de Labesse, maire, demande 100 livres de dommages-intérêts reversibles à l’Hôpital. Mme Forien des Places en demande 600 applicables à toute maison gênée ou à tous les citoyens de la ville ayant une nombreuse famille… M. Pastoureau de Labesse épousa Marguerite Marcillaud du Genest dont : un fils, lieutenant-colonel d’artillerie, marié à demoiselle Lapeyre de Bellair ; un fils, officier des Eaux et Forêts, marié à Dlle Marguerite de Labrousse du Bosfrand ; et deux filles représentées au XIXe siècle par le marquis de La Garde, les Marcillaud de Goursac, les de Grandillac et de Jaurias. La veuve Forien des Places ne parvenant pas à s’entendre avec son voisin, a pris le parti de se dessaisir de sa maison. Son acquéreur, le citoyen Fonreau — fin 1792, il n’y a plus que des citoyens — transige à l’amiable le 24 décembre : « Entre les citoyens soussignés, Pierre Pastoureau Labesse et Pierre Emeric Fonreau, tous deux habitants de la ville de Nontron, il a été arrêté et convenu ce qui suit : savoir que pour éviter toutes discussions et terminer en même temps les différents survenus entre la citoyenne Marthe Arbonneau, veuve Forien, actuellement représentée par le cit. Emeric Fonreau, comme acquéreur de la maison de la dite citoyenne veuve Forien qui avait donné lieu aux contestations entre le citoyen Pastoureau et elle relativement aux jours qu’elle prétendait éclairer les appartements de sa maison… » etc. etc. Trois pages de concessions, de mutuels engagements : « De bonne fois… L’An 1r de la République. » Les deux fils de la plaignante, Augustin et Pierre, mariés à Nontron An XI et An XII avec Elisabeth Cuttet et Louise Bignon, quitteront leur ville natale pour s’établir dans la Haute-Vienne où leur nom se déformant deviendra Faurien.
(Nontron dans l’Histoire)
-
Je suis d’une taille médiocre, libre et bien proportionnée. J’ai le teint brun, mais assez uni ; le front élevé, et d’une raisonnable grandeur ; les yeux noirs, petits et enfoncés ; et les sourcils noirs et épais, mais bien tournés. Je serois fort empêché de dire de quelle sorte j’ai le nez fait ; car il n’est ni camus, ni aquilin, ni gros, ni pointu, au moins à ce que je crois : tout ce que je sais, c’est qu’il est plutôt grand que petit, et qu’il descend un peu trop bas. J’ai la bouche grande, et les lèvres assez rouges d’ordinaire, et ni bien ni mal taillées. J’ai les dents blanches et passablement bien rangées. On m’a dit autrefois que j’avois un peu trop de menton : je viens de me regarder dans le miroir pour savoir ce qui en est ; et je ne sais pas trop bien qu’en juger. Pour le tour du visage, je l’ai ou carré ou ovale ; lequel des deux, il me seroit difficile de le dire. J’ai les cheveux noirs, naturellement frisés, et avec cela assez épais et assez longs pour pouvoir prétendre en belle tête.
J’ai quelque chose de chagrin et de fier dans la mine : cela fait croire à la plupart des gens que je suis méprisant, quoique je ne le sois point du tout. J’ai l’action fort aisée, et même un peu trop, et jusqu’à faire beaucoup de gestes en parlant. Voilà naïvement comme je pense que je suis fait au dehors ; et l’on trouvera, je crois, que ce que je pense de moi là-dessus n’est pas fort éloigné de ce qui en est. J’en userai avec la même fidélité dans ce qui me reste à faire de mon portrait ; car je me suis assez étudié pour me bien connoître, et je ne manquerai ni d’assurance pour dire librement ce que je puis avoir de bonnes qualités, ni de sincérité pour avouer franchement ce que j’ai de défauts.
Premièrement, pour parler de mon humeur, je suis mélancolique, et je le suis à un point que depuis trois ou quatre ans à peine m’a-t on vu rire trois ou quatre fois. J’aurois pourtant, ce me semble, une mélancolie assez supportable et assez douce, si je n’en avois point d’autre que celle qui me vient de mon tempérament ; mais il m’en vient tant d’ailleurs, et ce qui m’en vient me remplit de telle sorte l’imagination et m’occupe si fort l’esprit, que la plupart du temps, ou je rêve sans dire mot, ou je n’ai presque point d’attache à ce que je dis. Je suis fort resserré avec ceux que je ne connois pas, et je ne suis pas même extrêmement ouvert avec la plupart de ceux que je connois. C’est un défaut, je le sais bien, et je ne négligerai rien pour m’en corriger : mais comme un certain air sombre que j’ai dans le visage contribue à me faire paraître encore plus réservé que je ne le suis, et qu’il n’est pas en notre pouvoir de nous défaire d’un méchant air qui nous vient de la disposition naturelle des traits, je pense qu’après m’être corrigé au-dedans, il ne laissera pas de me demeurer toujours de mauvaises marques au dehors.
J’ai de l’esprit et je ne fais point difficulté de le dire car à quoi bon façonner là dessus tant biaiser et tant apporter d’adoucissement pour dire les avantages que l’on a c’est ce me semble cacher un peu de vanité sous une modestie apparente et se servir d’une manière bien adroite pour faire croire de soi beaucoup plus de bien que l’on n’en dit. Pour moi je suis content qu’on ne me croie ni plus beau que je me fais, ni de meilleur humeur que je me dépeins, ni plus spirituel et plus raisonnable que je le suis. J’ai donc de l’esprit encore une fois, mais un esprit que la mélancolie gâte ; car encore que je possède assez bien ma langue, que j’aie la mémoire heureuse, et que je ne pense pas les choses fort confusément, j’ai pourtant une si forte application à mon chagrin, que souvent j’exprime assez mal ce que je veux dire.
La conversation des honnêtes gens est un des plaisirs qui me touchent le plus. J aime qu’elle soit sérieuse, et que la morale en fasse la plus grande partie. Cependant je sais la goûter aussi lorsqu’elle est enjouée, et si je ne dis pas beaucoup de petites choses pour rire, ce n’est pas du moins que je ne connoisse pas ce que valent les bagatelles bien dites, et que je ne trouve fort divertissante cette manière de badiner, où il y a certains esprits prompts et aisés qui réussissent si bien. J’écris bien en prose, je fais bien en vers, et si j’étois sensible à la gloire qui vient de ce côté-là, je pense qu’avec peu de travail je pourrois m’acquérir assez de réputation.
J’aime la lecture en général : celle où il se trouve quelque chose qui peut façonner l’esprit et fortifier l’âme est celle que j’aime le plus. Surtout j’ai une extrême satisfaction à lire avec une personne d’esprit ; car de cette sorte on réfléchit à tout moment sur ce qu’on lit, et des réflexions que l’on fait il se forme une conversation la plus agréable du monde et la plus utile.
Je juge assez bien des ouvrages de vers et de prose que l’on me montre ; mais j’en dis peut-être mon sentiment avec un peu trop de liberté. Ce qu’il y a encore de mal en moi, c’est que j’ai quelquefois une délicatesse trop scrupuleuse et une critique trop sévère. Je ne hais pas entendre disputer, et souvent aussi je me mêle assez volontiers dans la dispute : mais je soutiens d’ordinaire mon opinion avec trop de chaleur ; et lorsqu’on défend un parti injuste contre moi, quelquefois, à force de me passionner pour la raison, je deviens moi-même fort peu raisonnable.
J’ai les sentimens vertueux, les inclinations belles, et une si forte envie d’être tout à fait honnête homme, que mes amis ne me sauroient faire un plus grand plaisir que de m’avertir sincèrement de mes défauts. Ceux qui me connoissent un peu particulièrement, et qui ont eu la bonté de me donner quelquefois des avis là-dessus, savent que je les ai toujours reçus avec toute la joie imaginable, et toute la soumission d’esprit que l’on sauroit désirer.
J’ai toutes les passions assez douces et assez réglées : on ne m’a presque jamais vu en colère, et je n’ai jamais eu de haine pour personne. Je ne suis pas pourtant incapable de me venger si l’on m avoit offensé et qu’il y allât de mon honneur à me ressentir de l’injure qu’on m’auroit faite ; au contraire je suis assuré que le devoir feroit si bien en moi l’office de la haine que je poursuivrois ma vengeance avec encore plus de vigueur qu’un autre.
L’ambition ne me travaille point. Je ne crains guère de choses et ne crains aucunement la mort. Je suis peu sensible à la pitié, et je voudrois ne l’y être point du tout. Cependant il n’est rien que je ne fisse pour le soulagement d’une personne affligée, et je crois effectivement que l’on doit tout faire, jusqu’à lui témoigner même beaucoup de compassion de son mal ; car les misérables sont si sots, que cela leur fait le plus grand bien du monde. Mais je tiens aussi qu’il faut se contenter d’en témoigner et se garder soigneusement d’en avoir : c’est une passion qui n’est bonne à rien au dedans d’une âme bien faite, qui ne sert qu’à affoiblir le cœur, et qu’on doit laisser au peuple, qui n’exécutant jamais rien par raison, a besoin de passions pour le porter à faire les choses.
J’aime mes amis et je les aime d’une façon que je ne balancerais pas un moment à sacrifier mes intérêts aux leurs. J’ai de la condescendance pour eux, je souffre patiemment leurs mauvaises humeurs : seulement je ne leur fais beaucoup de caresses, et je n’ai pas non plus de grandes inquiétudes en leur absence.
J’ai naturellement fort peu de curiosité pour la plus grande partie de ce tout qui en donne aux autres gens. Je suis fort secret, et j’ai moins de difficulté que personne à taire ce qu’on m’a dit en confidence. Je suis extrêmement régulier à ma parole ; je n’y manque jamais, de quelque conséquence que puisse être ce que j ai promis ; et je m’en suis fait toute ma vie une loi indispensable. J’ai une civilité fort exacte parmi les femmes ; et je ne crois pas jamais avoir rien dit devant elles qui leur ait pu faire de la peine. Quand elles ont l’esprit bien fait, j’aime mieux leur conversation que celle des hommes : on y trouve une certaine douceur qui ne se rencontre point parmi nous ; et il me semble, outre cela, qu’elles s’expliquent avec plus de netteté, et qu’elles donnent un tour plus agréable aux choses qu’elles disent. Pour galant, je l’ai été un peu autrefois ; présentement je ne le suis plus, quelque jeune que je sois. J’ai renoncé aux fleurettes et je m’étonne seulement de ce qu’il y a encore tant d’honnêtes gens qui s’occupent à en débiter.
J’approuve extrêmement les belles passions ; elles marquent la grandeur de l’âme ; et quoique dans les inquiétudes qu’elles donnent il y ait quelque chose de contraire à la sévère sagesse, elles s’accommodent si bien d’ailleurs avec la plus austère vertu, que je crois qu’on ne les sauroit condamner avec justice. Moi, qui connois tout ce qu’il ya de délicat et de fort dans les grands sentimens de l’amour, si jamais je viens à aimer, ce sera assurément de cette sorte : mais, de la façon dont je suis, je ne crois pas que cette connoissance que j’ai me passe jamais de l’esprit au cœur.
Source : Nouvelle collection des mémoires pour servir à l’histoire de France depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe, de Joseph-François Michaud.
-
Naissance de François VI
Premier des sept garçons et sept filles qu’eurent le comte (puis duc et pair à partir de 1622) François V de La Rochefoucauld et Gabrielle du Plessis-Liancourt, François VI naquit le 15 septembre 1613, à deux heures et demie de l’après-midi, rue des Petits Champs, près du Louvre, à Paris. « Le père est un grand féodal, orgueilleux et mécontent ; la mère est de nature tendre et effacée » (Georges Grappe).
Vingt-et-unième descendant de Foucauld Ier, seigneur de La Roche, qui vécut vers l’an 1000, au temps du roi Robert Le Pieux, le nouveau-né fut prénommé François. C’était l’usage pour tous les aînés de la famille depuis que François Ier de La Rochefoucauld, chambellan de Charles VIII et de Louis XII, avait eu l’honneur d’être choisi en 1497 comme parrain du roi François Ier. Celui-ci, par lettres d’avril 1515 enregistrées en 1528, érigea la terre, seigneurie et baronnie de La Rochefoucauld en comté. Dans ces lettres, François Ier de La Rochefoucauld est qualifié de « très cher et aimé cousin et parrain ». Ce titre de cousin sera rappelé dans les lettres par lesquelles Louis XIII érigera, en 1622, le comté en duché-pairie.
Par tradition également, François VI, comme tous les aînés des La Rochefoucauld, porta dès le berceau et jusqu’à la mort de son père, le titre de prince de Marcillac, qui était tiré du nom d’une possession d’Angoumois, où s’élevait un château acquis par Guy VIII de La Rochefoucauld au mye siècle. Saint-Simon parlera, dans ses Mémoires, de ce « vain titre » de prince de Marcillac, et Jean Lafond, dans sa préface aux Mémoires de La Rochefoucauld en 2006, de « prince de fantaisie ».
François VI fut baptisé le 4 octobre 1613 à Paris, en l’église Saint Honoré, par monseigneur Antoine de La Rochefoucauld, évêque d’Angoulême. Au-dessus des fonts baptismaux se penchaient le parrain : le cardinal François de La Rochefoucauld, évêque de Senlis, grand aumônier de France, commandeur des ordres du roi et écrivain fécond ; et la marraine, qui était en même temps la grand-mère de l’enfant : Antoinette de Pons, marquise de Guercheville, épouse de Charles du Plessis-Liancourt.
Les maisons de la famille
L’enfance du petit prince de Marcillac eut pour cadre, en partie, les maisons que sa famille possédait en Angoumois et en Poitou, et surtout le château de Verteuil, situé à une lieue et demie de Ruffec. Verteuil, qui appartenait aux La Rochefoucauld depuis le XIe siècle, était bâti, indique Jean Gervais, lieutenant criminel au présidial d’Angoulême sous Louis XV, dans son Mémoire sur l’Angoumois, sur « une baronnie composée de neuf ou dix paroisses, à la tête desquelles est la petite ville de ce nom, à sept lieues d’Angoulême, composée de cent feux. Les habitants en sont communément pauvres (…). Cette terre seule ne vaut pas plus de cinq mille livres de ferme. »
Forteresse romane à l’origine, Verteuil, ce « moult fort chasteau du Poitou, sur les marches du Limousin et de la Saintonge », selon l’expression du grand chroniqueur Froissart, fut démantelé en 1442, durant la Praguerie, sur ordre du roi Charles VII qui avait décidé de châtier un aïeul indocile de François VI. La chapelle et le donjon furent cependant épargnés, et au milieu du XVe siècle, Guillaume de La Rochefoucauld fit reconstruire la demeure, lui donna sa forme triangulaire, l’orna de trois tours à mâchicoulis et de grandes voûtes longues de soixante-cinq mètres et hautes de dix mètres.
Surplombant fièrement la Charente et ses rives ombragées, entouré de bois giboyeux, Verteuil était agrémenté de parcs dont la beauté força l’admiration des contemporains. Jean Gervais en témoigne dans son Mémoire sur l’Angoumois : Les issues de Verteuil, connues sous le nom de parc de Vauguay, ont des beautés naturelles qui surpassent peut-être tout ce qu’on peut voir en France. Le parc, d’une étendue des plus spacieuses, s’est trouvé contenir un terroir très propre à élever des arbres, et les plants de charmilles et autres espèces y ont si bien réussi, qu’il n’y en a point ailleurs d’une semblable hauteur, de si belles tiges et si bien fournies. On y entretient aussi une orangerie superbe.
Le parc de la Tremblaye, qui y est joint, est une forêt entière, brute, tout enfermée de hauts murs, dans laquelle il y a nombre de bêtes. Les arbres en sont aussi forts beaux. Elle est coupée au milieu par une grande allée dont le point de vue, qui répond par d’autres allées à la porte du château, forme une des plus belles perspectives du monde. »
Cette résidence agréable et magnifique, dotée d’une bibliothèque remarquable pour l’époque, accueillit des hôtes de marque, en particulier Charles Quint, de passage en France en 1539 et qui, de Verteuil, se rendit au château de Loches pour y rencontrer le roi François Ter. Bien que victime d’un rhume tenace depuis Hendaye, Charles Quint ne put s’empêcher d’exprimer son admiration à l’égard des endroits qu’il traversait. Il disait avoir vu cinq merveilles en France : un monde, une ville, un village, un jardin et une maison, à savoir : Paris, Orléans, Poitiers, Tours et la maison de La Rochefoucauld. À propos de celle-ci, il ajouta qu’il n’avait jamais été maison qui sentît mieux sa grande vertu, honnêteté et seigneurie que celle-là. » Il planta, dans le parc de Verteuil, un conifère qu’on voit encore aujourd’hui. Pendant les guerres de Religion, du fait que François III s’était converti au protestantisme, le château abrita le sixième synode de l’église réformée.
Les La Rochefoucauld, attirés par le charme de ces lieux, séjournaient moins dans leurs autres domaines disséminés, en majeure partie, du Périgord à la Loire. Parmi ceux-ci, la place prééminente revient à la baronnie, puis comté et enfin duché de La Rochefoucauld, berceau de la famille. Au IXe siècle, un fort destiné à défendre la contrée contre les envahisseurs normands, fut édifié sur la roche qui domine la vallée traversée par la rivière Tardoire. Ensuite, Foucauld Ier, seigneur de La Roche, fit bâtir sur l’emplacement du fort primitif, à six lieues d’Angoulême, un puissant château qui, depuis 1026, exprime avec éclat la majesté féodale. Sous Foucauld II, la bourgade, qui s’étendait au pied de la construction guerrière, commença d’être appelée La Roche Foucauld.
Le château de La Rochefoucauld, surnommé da perle de l’Angoumois », flanqué d’un donjon carré haut de trente-cinq mètres, hérissé de tours rondes, s’élève sur une rive de La Tardoire. Les initiatives architecturales, au XVIe siècle, de François II de La Rochefoucauld et de son épouse Anne de Polignac témoignent encore aujourd’hui d’un goût très sûr si l’on considère les ailes principales, les trois galeries superposées et ajourées conçues selon certains à partir de dessins de Léonard de Vinci initialement commandés pour un autre château, l’ingénieux grand escalier de cent-huit marches, les plafonds à caissons. Marguerite de Valois, auteur de l’Heptaméron, sœur du roi François Ier, séjourna dans cette demeure. Parmi les pièces qui étaient mises à sa disposition, on peut encore admirer un petit salon entièrement lambrissé.
Jean Gervais indique, dans son Mémoire sur l’Angoumois, que la terre de La Rochefoucauld comprenait vingt paroisses et rapportait dix-mille livres de rente.
Autre demeure, beaucoup plus rustique mais pourtant prisée par François VI de La Rochefoucauld, qui en fera en quelque sorte une maison des champs où il écrira notamment des lettres et deux de ses testaments : le château de la Terne, grande bâtisse sans tour allongée sur une rive de la Charente, près de Luxé. La Terne était située sur la baronnie de Montignac. Celle-ci, « à quatre lieues d’Angoulême, explique Jean Gervais, appartenant au même seigneur, contient vingt-quatre paroisses et peut valoir huit mille livres de revenu. Le chef-lieu du même nom est un petit bourg qui contient, compris Saint-Étienne joint, quelque quatre-vingt-onze feux. Il n’y a que quelques petits cabaretiers et artisans que les foires y entretiennent. Le reste est bas peuple et pauvre. Le château est presque tout en vieille masure. »
Encore à proximité d’Angoulême s’élevait le château de Marcillac, construit vers le IXe siècle. Depuis François II de La Rochefoucauld, le fils aîné de la famille, du vivant de son père, porte le titre de prince de Marcillac.
À la tête du duché de La Rochefoucauld, de la principauté de Marcillac, des baronnies de Verteuil, Marthon, Tourriers, Montignac, des chastellenies de Saint-Laurent de Céris, Saint-Claud, Cellefrouin, Aunac, Bayers, Saint-Amant-de-Bonnieure, des seigneuries de Saint-Angeau et autres fiefs, les La Rochefoucauld possédaient encore bien d’autres terres, notamment en Périgord et en Agénois. Mais d’étendue de ces domaines, observe Antoine Adam, ne doit pas faire illusion sur l’importance de leurs revenus. Les embarras d’argent que La Rochefoucauld a connus ne s’expliquent pas seulement par les dépenses qu’entraînèrent pour lui les guerres civiles. »
Éducation de François VI
Dans ces résidences solennelles, enfouies au sein de calmes paysages, François VI vécut paisiblement ses premières années. « C’est là que (François V) élève son fils, si les soins qu’il prend de son éducation méritent ce nom. Dès que l’adolescent est assez robuste, il lui fait enseigner le métier des armes. Il l’associe à ses plaisirs favoris, le cheval et la chasse. Au cours de ces randonnées communes, il ressasse à l’enfant toutes les choses de sa caste et de sa race, ses orgueils et ses rancœurs, ses héroïsmes et ses préjugés. C’est là, vraisemblablement, dans le plein des bois, dans les taillis sans espions qu’il invective contre le cardinal, destructeur des privilèges de la noblesse. C’est là qu’il nourrit son fils dans ces sentiments. On ne voit pas au-delà trace de son influence sur ce jeune caractère. » (Georges Grappe). Il reçut l’éducation d’un grand seigneur, c’est-à-dire apprit les arts nécessaires à un homme d’épée » (Marius Roustan).
Les documents sur cette période sont rares, et on suppose que l’éducation de l’enfant fut assez négligée, essentiellement tournée vers le développement de l’être physique. François VI reconnaîtra dans une lettre qu’il n’entendait pas bien le latin. « M. de La Rochefoucauld n’avait pas étudié ; mais il avait un bon sens merveilleux, et il savait parfaitement le monde », nota le poète Segrais qui le connaissait bien, et dont l’opinion est confortée par celle de Mme de Maintenon : « Il avait (…) beaucoup d’esprit, mais peu de savoir ». Selon Sainte-Beuve, « il n’avait pas étudié et ne mêlait à sa vivacité d’esprit qu’un bon sens naturel encore masqué d’une grande imagination. »
Jusqu’à l’âge de douze ans, François VI eut pourtant un précepteur : le poitevin Julien III Collardeau de la Mongie (1596-1669), homme de lettres (il publiera Larvina Satyricon en 1619 et Tableaux des victoires de Louis XIII en 1630) et juriste, procureur du roi à Fontenay-le-Comte. Celui-ci lui apprit à lire, un peu de latin, et, ajouta Edmée de La Rochefoucauld, « peut-être le goût de faire le procès des humains. » Dans un billet du 8 novembre 1626, Julien Collardeau déclare « avoir reçu de M. l’abbé de La Réau, agissant au nom de Mgr de La Rochefoucauld, la somme de soixante livres tournois, en deniers ayant cours, pour le dernier quartier de la gratification à moi allouée par ledit seigneur en récompense d’avoir enseigné les lettres à M. le prince de Marcillac, et du tout l’en tient quitte. »
François VI passa cette période d’éducation à Fontenay-le-Comte, dans la « maison du gouverneur » de cette ville, qui était son père, nommé à cette charge en 1621 par Louis XIII : à l’intérieur de la province du Poitou qui était placée sous l’autorité d’un gouverneur général, les villes de Poitiers, Loudun, Châtellerault, Niort, Melle et Fontenay étaient dotées d’un gouverneur particulier.
Le prince de Marcillac, dont une des futures maximes dira qu’ « il est plus nécessaire d’étudier les hommes que les livres », montra cependant très tôt du goût pour la littérature : régulièrement, il se plongeait dans le fameux et interminable roman des amours du berger Céladon et de la bergère Astrée, qu’Honoré d’Urfé publia de 1610 à 1625. Il garda sans doute cette habitude toute sa vie puisque Mme de Sévigné, dans une lettre de 1671, dira qu’elle partageait avec lui son goût prononcé « pour ces sottises-là ». L’Astrée, et l’Astrée seul, a été le premier éducateur de La Rochefoucauld, comme homme et comme gentilhomme. C’est dans ce livre qu’il a puisé ces leçons romanesques qui, jusqu’à sa trentième année, ont fait de lui un personnage poétique, noble entre tous, imaginant le monde à la ressemblance de la société idyllique réunie sur les bords du Lignon. C’est pour avoir cru à cette fable — de toute son âme — qu’il s’est voué au service des dames, au service de la reine Anne, de Mlle de Hautefort, de la duchesse de Chevreuse : « La jeunesse est une ivresse continuelle ; c’est la fièvre de la raison », a-t-il écrit dans les Maximes » (G. Grappe).
Mais l’enfant accorda sans doute beaucoup plus d’importance à la chasse dans les bois de Tusson et d’Avon, ou à la pêche dans la Charente et ses affluents, qu’à l’acquisition des connaissances générales qui forment la base intellectuelle d’une vie.
Source : La Rochefoucauld le duc rebelle, d’Alain Mazère.